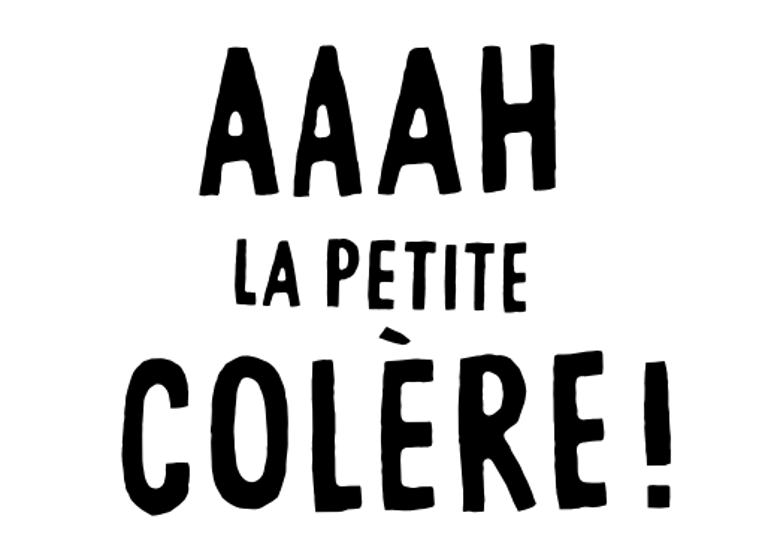L'effet du trauma et sa guérison à l'aide des espaces collectifs


L'effet du trauma:
Suite à un choc traumatique ou à des atteintes répétées sur le système nerveux, une coupure sera enregistrée dans la partie du cerveau reptilienne, qui dorénavant captera de manière analogique les stimuli qui pourraient reproduire cette surchauffe.
Les souvenirs traumatiques sont donc déclenchés par des éléments précis, qui rappellent le trauma. Il peut donc s’agir d’associations propres à la personne traumatisée: un pull bleu, une porte qui se ferme, un ton de voix,... il peut aussi s’agir de mots ou de sujets évoqués, qui vont faire en sorte que la personne recontacte des anciens souvenirs. Le spectre de l’activation est donc vaste et… infini. Et les militants qui vont chercher à lutter autour de thématique qui les ont blessées personnellement courent le risque d’être activée dans leur trauma, surtout si elles sont exposées seules (ou avec un sentiment de solitude à ce moment-là) à cette activation.
Lorsque des traces mnésiques d’images, de sensations et de son initiaux sont réactivées, le lobe frontal se ferme - de sorte que la capacité de mettre en mots les émotions n’existe plus, tout comme le sens du temps, puisqu’ils sont pilotés tous les deux par cette région cérébrale-là. “A ce stade, le cerveau émotionnel (le système limbique et le tronc cérébral), qui n’est pas contrôlé consciemment et ne peut pas communiquer verbalement, prend le dessus”. L’expérience du trauma, qui n’a pas été intégré dans la mémoire autobiographique, est revécu à l’identique. Le danger est ressenti comme une expérience physique envahissante, revécue dans le temps présent.
Ces stimuli déclencheront ce qu’on appelle une réponse “involontaire” (il sera inutile de rationaliser le phénomène): le système nerveux autonome aura pris le dessus. La personne sera réactivée de manière automatique. C’est ce qu’on appelle le stress post-traumatique.
Ainsi, dans le cas de stress post-traumatique, la personne traumatisée continue à se comporter comme si le(s) danger(s) qu’elle a vécu(s) dans le passé et qu’elle sait “cognitivement” être “passé(s)”, étaient d’une certaine manière toujours présents, et ce, non pas tant sous forme “d’histoires’, mais sous forme de schémas moteurs accompagnés d’émotions intenses. Pour le docteur Schittecatte, “le traumatisme est dû à une réponse physiologique de figement de l’organisme tout entier (corps/émotion/esprit)”.
Ce qui est nouveau, par exemple, avec la découverte de Porges, c’est la prise de conscience que les humaines peuvent être pris dans des boucles nerveuses involontaires qui les mettent dans l’impossibilité réelle de faire certaines choses (le déserteurs de guerre étaient des grands traumatisés non-reconnu), ou que la réponse d’immobilisation ne correspond pas à du consentement (les victimes de violences sexuelles sont sidérées, et ne peuvent plus repousser). En somme, que la réponse d’immobilité pour raison nerveuse existe, et est même très courante.
Or, il n’est pas si simple de se remettre d’un trauma, car quand sidération ou dissociation il y a, les circuits de la mémoire biographique se coupent, laissant une trace mémorielle au niveau purement sensoriel, qui ne trouve pas réparation.
Globalement, cela fait seulement deux décennies que les grandes écoles thérapeutiques ont l'opportunité d’intégrer des nouvelles approches comprenant le (vrai) fonctionnement du système nerveux (la théorie polyvagale) et les théories de l’attachement… ce qui n’est pas sans changer l’approche des thérapies autour des traumatismes.
Pourtant, il reste des zones d’ombres dont, la principale, nous semble-t-il, est la question de la re-traumatisation. En effet, pour certaines écoles, il est nécessaire de “retourner” dans le trauma pour modifier la réponse corporelle et psychique de celui-ci, alors que pour d’autres, il est possible et souhaitable de résoudre ceux-ci sans faire appel à la mémoire traumatique, en augmentant la sensation de maîtrise ou de sécurité corporelle.
Pour Michel Shittecatte, en faveur d’un “retour” dans le trauma, la résolution du traumatisme est fondée, entre autre, sur la sortie de la réponse corporelle de figement, au moins sous la forme de représentation psychique, voire, sous forme corporelle (voir la préface de Reconstruire après les traumatismes).
Il s’agit dès lors de modifier la conscience corporelle qui peut se manifester sous la forme de pensées, d’images, d’émotions, ou encore de mouvements. A titre d’exemple, il peut s’agir d’imaginer ou de mettre en scène le fait de frapper, crier, repousser, fuir ou dans le cas de traumatisme du développement, désaimer, ne plus ressentir de la peur, dire non, ressentir du dégoût etc.
Ce qu’on appelle en théorie polyvagale l’”engagement social” ou la co-régulation (être accompagné par d’autres quand on est dérégulé nerveusement) est un des essentiels de la stabilisation du système nerveux et de la réorientation de la réponse traumatique. Ainsi, les espaces collectifs peuvent être des très bons espaces de co-régulation.
L'intérêt des espaces collectifs:
Les bénéfices potentiels des espaces collectifs est donc de participer à recréer du lien, là où certaines personnes en ont manqué puisque comme le rappelle Judith Herman dans Reconstruire après les traumatismes, “les événements traumatisants remettent en question des relations humaines de base. Ils rompent les liens d'attachement familiaux, l'amitié, l’amour et la collectivité”.
J'ai moi-même beaucoup fréquenté les espaces de thérapie collective et j'en ai trouvé très répidement beaucoup de bénéfices. Dans le podcast DissociationS S1E3, qui décrit les différents types de traumatismes, à part les traumatismes dit "T1" qui représentent un évènement unique et bref, délimité dans le temps (une catastrophe naturelle, un accident et éventuellement une agressions unique à l'âge adulte), les traumas dit T2 ou T3 implique les relations interpersonnelles. Le trauma dit T2 est un évènement répété et pouvant intervenir à tout moment, avec une facette interpersonnelle et le trauma dit T3 est qualifié par une série d'évènements interpersonnels mutiples envahissants et répétés, débutant à un âge précose (inceste, secte, etc.). Evelyn Josse dira de ces derniers qu'ils "résultent d'une intention déliberée de nuire, qui détruit l'intégrité et la dignité physique, psychologique et sociale, ruine l'estime de soi et le sentiment d'appartence au groupe d'origine, inéantisse la confiance en l'humanité, abîme le sens de la vie et bouscule la prévisibilité du monde". Cette définition m'a énormément touchée... que ce soit le caractère imprévisible du monde ou cet anéantissement de la confiance en l'humanité que j'ai ressenti puissament lors de ma sortie d'amnésie traumatique. Et je sais que c'est ce que j'ai retrouvé petit à petit dans les espaces collectifs: la croyance que le groupe pouvait être sécure, que l'humanité en vallait la peine. J'espère que vous pourrez faire le même chemin que moi.
C'est la raison pour laquelle il me tient à coeur de proposer des espaces d'écriture, d'expression et de régulation collectif. Pour en savoir plus consulter la page "ateliers" ou mon instagram: https://www.instagram.com/p/DRt8IM3DLis/